Le climat social de cette fin de siècle lui est néfaste, mais faut-il pour autant la cultiver si intensivement ? L’estime de soi est rebelle aux engrais artificiels; elle ne pousse bien que sur le terreau naturel du respect de soi.
Si vous ne voyez dans l’« estime de soi » qu’une des lassantes ritournelles de notre Nouvel Âge de la sensiblerie, lisez ou relisez Paradis perdu, l’immortel poème épique publié par John Milton en 1667. Vous y trouverez ces vers : « Maintes fois, rien n’est plus profitable / que l’estime de soi fondée sur le juste et le droit… »
En réalité, cette expression n’appartient au psychobabillage sirupeux de notre fin de siècle que par son… tsé j’veux dire… flou sémantique. D’extension en distorsion, elle s’est tellement éloignée de la « bonne opinion de soi-même » attestée par les dictionnaires qu’on l’emploie désormais en lieu et place d’une foule de notions voisines, mais bien distinctes comme respect de soi et confiance en soi. Cette confusion n’est pas sans conséquence, nous le verrons plus loin. Pour le moment, ce qu’il faut rappeler, c’est que le concept n’est pas neuf. L’inusité, c’est l’intérêt passionné qu’on lui porte.
Le climat social en Occident n’aide pas les gens à avoir bonne opinion d’eux-mêmes. Qui pis est, le problème apparaît à des âges de plus en plus tendres.
Combien, parmi la légion des enfants du divorce, nourrissent en secret le terrible sentiment d’avoir été abandonnés, rejetés ou, pire encore, d’avoir causé la rupture en décevant les espoirs de papa et maman ? Combien, parmi ceux qui ne voient presque jamais des parents dévorés par leur travail, assimilent cette absence à une critique muette de leurs lacunes ?
Dès l’adolescence, ces enfants fragilisés sont projetés dans un monde de permissivité quasi absolue qui les incite à tout essayer, même les expériences les plus démoralisantes. Le plus innocemment du monde, ils développent des accoutumances qui leur donnent le sentiment honteux de ne pas maîtriser leurs propres puisions, s’engagent dans des liaisons vite rompues qui les confortent dans l’idée de leur indignité. Et lorsqu’ils frappent à la porte du marché du travail, c’est souvent pour s’entendre répondre qu’il n’y a pas de place correspondant à leurs connaissances ou à leur intelligence. Ce qui n’est pas pour rehausser l’image déjà bien abîmée qu’ils ont de leurs capacités.
L’armée des travailleurs sacrifiés aux idoles de la rationalisation, de la mondialisation et du progrès technologique n’est pas mieux lotie. Comment ne pas douter de sa valeur en apprenant qu’on va perdre son poste alors que les autres conservent le leur ?
Le métier occupe une place si prépondérante dans l’identité sociale que les travailleurs licenciés ou contraints à une retraite anticipée se sentent humiliés par cette mise au rancart. Pour ces jeunes pensionnés comme pour tant d’aînés réduits à l’inactivité, l’accroissement de l’espérance de vie est une demi-malédiction puisqu’il prolonge leur purgatoire.
Ces drames privés sont la face sombre d’un culte public de la réussite qui traite l’échec comme une anomalie, voire une tare. Faillir, c’est mourir, et pas rien qu’un peu, dans l’Amérique contemporaine.
À en croire les experts, en effet, le mépris de soi naît du constat d’un décalage irrémédiable entre ses ambitions et ses capacités ou réalisations. On se croit nul dès lors qu’on n’est pas tout ce qu’on devait ou croyait pouvoir être.
Dans la longue histoire de l’humanité, notre époque est la seule où l’on observe ce fossé entre l’idéal et la réalité. Au moins jusqu’au début du vingtième siècle, la grande masse des êtres humains acceptait docilement la place qui lui était dévolue dans la société. La religion jouait un rôle clé dans ce conditionnement en prêchant l’humilité et la résignation à la volonté de Dieu. L’être humain pouvait certes rêver d’un sort meilleur, mais pas ici-bas. Cette félicité serait la récompense éternelle d’une vie conforme aux préceptes divins.
Faillir, c’est mourir, et pas rien qu’un peu, dans l’Amérique contemporaine.
Le grand vent du « Rêve américain » a balayé cette antique idéologie de la soumission en l’espace de quelques décennies. De nos jours, la promesse d’une ascension sociale illimitée s’incarne dans un petit groupe de personnalités arrivées au sommet à la force du poignet, dont les médias rappellent à l’envi le parcours exemplaire. Puisqu’il ou elle en a été capable, insinuent leurs panégyriques, pourquoi pas vous ?
Cette révolution sociale s’est accompagnée d’une déchristianisation hautement culpabilisante pour les individus. Oblitérez Dieu, et vous devenez seul responsable de l’échec de vos ambitions -ou de celles que vos parents avaient mises en vous.
Le langage populaire illustre cette mutation de façon saisissante. Le mot « perdant » marque désormais au fer rouge quiconque ne gravit pas aussi lestement que ses contemporains les échelons de la richesse, du statut et des relations. Sous-entendu : la vie est un concours auquel n’échouent que les personnes dépourvues de caractère, d’énergie, d’intelligence ou de beauté. Impossible d’avoir beaucoup d’estime pour soi-même quand on se perçoit -ou qu’on a l’impression d’être perçu -comme un raté !
La genèse du mouvement
Notre société produit non seulement beaucoup de perdants, mais même ce qu’on pourrait appeler des « perdants-nés » : des gens qui ne peuvent pas participer au concours à cause de leur race, de leur sexe, de leur condition physique ou de leur statut social… bref, à cause d’un misérable accident de naissance.
C’est au sein d’un de ces groupes d’exclus qu’est né le mouvement auquel nous devons la vogue actuelle de l’estime de soi. Il a surgi d’une thèse sociologique voulant que bon nombre des difficultés de la communauté afro-américaine soient l’expression d’un profond mépris de soi.
Le raisonnement est simple : les gens qui se déprécient adoptent instinctivement des comportements d’échec qui nuisent à leurs chances et au progrès de leur collectivité.
Dans sa version première, ce mouvement visait à redonner confiance aux jeunes Noirs des quartiers défavorisés en leur montrant qu’ils valaient autant que n’importe quel autre enfant. Il s’agissait, pour les enseignants, de vanter chaudement les moindres talents de leurs élèves pour que ceux-ci aient envie de les cultiver : Michael dessine à merveille, Jennifer chante comme un oiseau, Sarah n’a que des amis…
Dans un deuxième temps, la méthode s’est étendue aux enfants qui n’étaient pas socialement défavorisés, mais semblaient douter d’eux- mêmes pour une raison ou une autre : timidité, laideur, etc. Petit à petit, le développement de l’estime de soi est devenu partie intégrante de la mission de l’école, y compris dans les établissements les plus huppés.
Une marchandise frelatée
La vie scolaire s’est muée en une perpétuelle remise de prix : médailles, certificats, récompenses, tout était bon pour honorer les « super-enfants », surtout ceux qui n’avaient rien fait de spécial. Au grand dam d’une poignée de critiques convaincus que cette débauche de compliments développait moins la fierté que la vanité et risquait de rendre les jeunes inaptes à affronter les rudesses de l’existence.
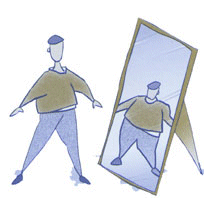
Cette mission incombe à la famille, arguaient-ils, et tout ce brouhaha n’aura plus de raison d’être si les parents manifestent un peu plus souvent leur approbation. De fait, l’enfant qui n’essuie que des reproches à la maison gobe rarement les flatteries, même bien intentionnées, de ses professeurs. Il est trop perspicace pour ne pas voir l’abîme qui sépare la rhétorique scolaire de la réalité domestique.
Les critiques prêchaient dans le désert. Le mouvement ne s’est pas éteint, il s’est étendu… au monde des adultes, d’autant plus aisément qu’il y avait là de l’argent à faire. L’estime de soi est devenue une marchandise. Frelatée, hélas !
La plupart des ouvrages sur ce thème se résument en effet à une pénible collection de rengaines, clichés et platitudes du genre : notez vos exploits sur des fiches cartonnées et gardez-les dans votre portefeuille pour pouvoir les relire quand vous déprimez. Vous êtes exhorté sur tous les tons à « réveiller le génie qui dort en vous ». Pour vous y aider, on vous propose qui un stage, qui une cassette vidéo, un jeu de société, des cartes de voeux…
Cette mini-industrie n’offre rien de gratuit, sauf le droit de s’admirer sans retenue ni raison valable. Son leitmotiv : quoique vous ayez fait dans la vie, vous méritez d’être fier de vous parce que vous existez. L’antithèse du péché originel, quoi !
Cette pseudo-théorie colle parfaitement avec l’attitude acritique qui est prônée dans certains cercles branchés au nom d’un principe qu’on pourrait formuler ainsi en paraphrasant l’Évangile : ne juge pas ton prochain pour ne pas être jugé toi-même.
Du doute au mépris
L’ennui, c’est que certaines personnes appliquent ce « nouveau commandement » non seulement à leur prochain, mais aussi à elles- mêmes. Si je n’ai pas le droit de condamner les fautes de mon voisin, au nom de quoi condamnerais-je les miennes ? Les psychologues de supermarché renforcent ce discours lénifiant en affirmant, comme cet auteur dont nous tairons le nom, qu’il « n’est pas nécessaire d’agir, il suffit d’être ».
Tous ces messages reviennent au fond à un seul : aime-toi toi-même, quoi qu’en pensent les autres. Chaque être mérite respect jusque dans ses défauts parce qu’il est unique.
Sur Internet circule une Déclaration du droit à l’estime de soi très instructive à cet égard. Le lecteur est censé proclamer : JE SUIS MOI PARTOUT, PERSONNE N’EST PARFAITEMENT IDENTIQUE À MOI, TOUT CE QUI VIENT DE MOI EST AUTHENTIQUEMENT MIEN PUISQUE JE L’AI DÉCIDÉ MOI-MÊME. Le tout doit sans doute être récité comme une litanie jusqu’à assimilation complète.
L’autonomie affective n’est pas une folie; le mépris de soi naît souvent d’un asservissement malsain à l’opinion d’autrui. Pour simplifier un peu les constats des psychologues, on pourrait dire que l’estime de soi se nourrit de l’amour et de l’appréciation des autres; retirez-lui ses deux aliments, et elle meurt d’inanition.
Les personnes qui doutent profondément d’elles-mêmes ont tendance à se chercher un « maître à penser » dont elles épousent aveuglément l’opinion; exprime-t-il la moindre critique à leur encontre qu’elles s’effondrent, persuadées de leur « indignité », et adoptent des comportements auto-destructeurs pour mieux lui donner raison. Du doute elles passent au mépris d’elles-mêmes, puis à une dépression chronique qui peut les conduire à en finir avec une vie que l’indifférence présumée des autres (et surtout de ce « maître » ) a rendu insupportable.
Une mini-industrie qui n’offre rien de gratuit, sauf le droit de s’admirer sans retenue ni raison valable.
L’autodépréciation peut aussi être le fruit d’un choc externe ravageur -abus sexuel, violence domestique, abandon conjugal -ou encore d’une infirmité congénitale ou accidentelle. Dans tous ces cas, la victime se sent diminuée par un malheur dont elle n’est en rien responsable.
Que ces gens aient besoin d’aide, nul ne le conteste. Qu’ils la trouvent dans des recettes miracle banalisant les causes de leur douleur, c’est beaucoup moins sûr. Ces panacées bon marché risquent au contraire de les enfoncer un peu plus s’ils ont le malheur de les essayer… et de constater qu’elles ne marchent pas. Ce qu’il leur faut, c’est le soutien et l’affection de gens qui savent ce qu’ils ressentent parce qu’ils vivent les mêmes tourments.
Une notion aussi vieille que la civilisation
Soutien : voilà le secret. Sans le ferme appui de ses proches, la victime s’abîme dans une mer de souffrance psychologique. L’autonomie affective est une nécessité, mais prôner cela comme seul remède au manque d’estime de soi, c’est nier l’essence même de la nature humaine.
À moins d’être un psychopathe, l’homme veut être apprécié de ses semblables. Cela est inscrit dans ses gènes. Voyez comme les enfants s’inquiètent d’être aimés des camarades qu’ils préfèrent. Et pourquoi nous soucions-nous tant de notre apparence si ce n’est pour nous faire bien voir de nos pairs ?
Ce qui nous ramène à la confusion entre estime et respect de soi. De nos jours, on donne le même sens à ces deux expressions alors qu’elles ont des connotations bien différentes : l’estime de soi vient de l’intérieur, le respect de soi, de l’extérieur. Si l’âme était une maison, ta première en serait le plafond et le second, le toit.
On peut avoir une très haute opinion de soi-même pour des motifs qui échappent totalement à son voisin, mais si on jouit de l’estime de ce voisin pour une raison valable, alors on peut prétendre non seulement au respect d’autrui, mais aussi au respect de soi.
Le mépris de soi s’exprime souvent par un sentiment d’indignité très significatif, car il renvoie à une notion aussi vieille que la civilisation. Suis-je digne de la bonne opinion que les autres ont de moi ? Qu’ai-je fait pour la mériter ? La seule estime de soi qui vaille est fondée sur le respect qu’on s’est acquis légitimement dans sa communauté.
Un aléa naturel de l’existence
Dans les vers cités au premier paragraphe, John Milton indique d’ailleurs bien que l’estime de soi profite à l’homme si elle s’appuie sur le juste et le droit. Seuls l’égoïste et le provocateur peuvent conserver une bonne opinion d’eux-mêmes en dehors de toute confirmation extérieure.
La provocation est du reste un trait caractéristique des personnes qui ne se respectent pas. Face aux reproches, le rebelle réplique : si cela ne vous a pas plu, attendez de voir la suite ! Lorsqu’on s’est déconsidéré à ses propres yeux, il est tentant de s’accorder l’indulgence en diluant ses normes de conduite. De glissement en dérapage, on se réduit à la compagnie de ceux qui ont fait le même choix, on s’habitue à des actions que l’honneur réprouve, et on détruit lentement mais sûrement toute l’estime qu’on avait pour soi- même.
Rien n’accroît plus l’estime de soi qu’une victoire sur l’adversité.
L’enfance est le seul état dans lequel l’être humain puisse jouir de l’estime de soi indépendamment du respect des autres. N’étant pas encore tenu pour responsable de ses actes, le tout-petit n’a aucune raison d’avoir honte de lui à moins que ses parents ne s’évertuent à l’humilier Le pire qu’ils puissent faire, à cet égard, c’est sans doute de se ridiculiser. L’enfant souffre toujours vivement de la censure sociale qui frappe ses parents, car il est indissolublement identifié à eux. Comment pourrait-il avoir du respect pour lui-même si ses principaux modèles n’en ont pas ?
Quant à nous qui avons quitté ce havre, nous devrions nous garder des diagnostics hâtifs : contrairement au mythe populaire, une vie banale n’est pas ratée ! Au grand jeu de la réussite, il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. C’est la loi de la moyenne. Le succès exige des sacrifices personnels d’une ampleur qui dissuade la plupart des candidats.
Il y a lieu également de bien distinguer ce qui relève de notre responsabilité de ce qui nous échappe. Nous n’avons pas barre sur la conjoncture économique, le climat social ou l’hérédité, mais il n’appartient qu’à nous de traiter les épreuves de l’existence comme un défi à notre courage plutôt que comme une injustice du sort. Rien n’accroît plus l’estime de soi qu’une victoire sur l’adversité.
Gardons aussi en mémoire qu’il est normal de voir ses espoirs déçus assez souvent. Ce n’est pas un signe d’échec, encore moins d’incapacité; c’est un aléa naturel de l’existence. Les petits revers ne sont d’ailleurs pas entièrement mauvais : ils nous révèlent ce qui sépare le superficiel de l’essentiel, le plaisir fugace du contentement durable.

Enfin, tenons pour acquis qu’il est plutôt sain de douter de soi de temps en temps. « Il est dans la nature humaine de se croire inférieur », a écrit Alfred Adler, l’un des pères de la psychologie. Chose certaine, mieux vaut se sous-estimer que le contraire. Les gens qui se surestiment s’imaginent trop facilement que les règles de la bienséance ne s’appliquent pas à eux, qu’ils sont au-dessus de ces médiocres conventions. Aveuglés par leur égoïsme exacerbé, ils ne font aucun cas de l’opinion d’autrui, ce qui les conduit en général à blesser tout le monde.
Chez les personnes à peu près équilibrées, l’estime de soi oscille au gré des circonstances. Elle sert de baromètre moral : elle monte après une bonne action, elle descend lorsque le remords la sape. En règle générale, plus on se montre exigeant avec soi-même, plus on se sent fier de soi.
Qu’on en fasse trop, et de façon trop brouillonne, pour cultiver l’estime de soi ne signifie pas que le problème soit imaginaire. Nous connaissons tous des gens qui se déprécient sans motif valable; si nous avons de bonnes raisons de les respecter, il importe de le laisser voir.
Ce qu’il ne faut jamais oublier, cependant, c’est que l’estime de soi ne s’octroie pas; elle se mérite. Elle prend racine dans le respect de soi qu’induit naturellement celui des autres. Et cela vaut pour vous et moi comme pour tous nos semblables.

