Un brin de philosophie dissipe comme par magie les frustrations de la vie quotidienne et aide mieux encore à clarifier les grands enjeux sociaux. Nous aurions tort de bouder la sagesse séculaire qui s’exprime dans les proverbes, maximes et dictons populaires. Vous ne les avez pas appris par coeur, comme vos grands-parents ? Il en existe d’excellents recueils…
Depuis quelque temps, les journaux relatent d’étranges histoires sur les « enragés de la route ». Ces automobilistes mutants sont tellement irrités par l’impolitesse (pour ne pas dire plus) d’un autre conducteur qu’ils en perdent les pédales et se vengent en emboutissant l’offenseur, en le forçant à sortir de la route ou même, en lui tirant dessus au risque de le tuer. Le nombre de ces affrontements à tombeau ouvert croît à une vitesse alarmante : selon une étude américaine, ces altercations absurdes tuent ou blessent gravement au moins 1 500 hommes, femmes et enfants chaque année aux États-Unis.
Quoique récent, ce syndrome a déjà ses experts, qui prescrivent unanimement un remède datant de la plus haute antiquité : tendre l’autre joue. Ne répliquez pas au klaxonneur. Laissez le talonneur vous dépasser à la première occasion et n’essayez pas de lui rendre la monnaie de sa pièce. Prenez un chemin de traverse pour semer le harceleur… bref, ravalez votre amour-propre et votre colère.
Ce conseil, c’est de la philosophie à l’état pur. Il nous exhorte à brider nos instincts et nous rappelle que c’est là le prix que nous devons tous payer pour vivre dans une société civilisée. Il nous suggère qu’il faut parfois plus de courage pour décliner un combat que pour le livrer. Il nous apprend, enfin, que « mieux vaut subir un tort que le causer », comme disait le grand penseur anglais Samuel Johnson.
La plupart des gens conçoivent la philosophie comme un jeu intellectuel abstrait, mais dans sa fonction sociale traditionnelle, elle est un monument de sens pratique. Y a-t-il rien de plus pragmatique que son traitement des crises de rage au volant ? Répliquer à une queue de poisson par une bordée d’injures ou par un bras d’honneur ne vous aide pas à vous tirer d’embarras; au contraire, note une étude britannique, cela vous déconcentre au pire moment. Et comme les chauffards sont en général assez agressifs, votre « ennemi » risque de réagir violemment à l’insulte. « Mieux vaut arriver tard que jamais », conclut fort justement – et philosophiquement – un expert en la matière.
Cette rage est un symptôme spectaculaire de l’impatience quasi suicidaire dont souffre la société occidentale contemporaine. À l’origine de la plupart de ces incidents, on trouve en effet un conducteur tellement énervé par un ralentissement de la circulation qu’il viole froidement la loi, sans parler des règles de la politesse, pour forcer le passage. Les psychologues y voient l’expression d’un trait fondamental de la mentalité citadine moderne : la gratification quasi instantanée des désirs. Nous qui préparons des repas minute au four à micro-ondes, qui changeons de chaîne d’une simple pression du doigt, qui retirons de l’argent en quelques secondes au guichet automatique, nous avons si peu l’habitude d’attendre que le moindre contretemps nous agace prodigieusement.
L’efficacité virtuelle de la technologie moderne aggrave la frustration que nous ressentons lorsqu’elle nous trahit. Y a-t-il rien de plus vexant que de contempler, assis au volant d’une puissante voiture, le scintillant serpent d’un embouteillage ? Rien de plus exaspérant que de fixer l’écran glauque d’un ordinateur dernier modèle tombé en panne au milieu d’un travail urgent ?
La précipitation, au contraire de la patience, tend à aggraver les choses parce qu’elle pousse à l’action avant qu’on en ait pesé toutes les conséquences.
C’est alors qu’un brin de la philosophie dont s’inspirent les experts pour prévenir la rage au volant peut nous sauver de la crise de nerfs. Bâtie sur le socle d’une sagesse millénaire, elle n’a pas son pareil pour ramener une contrariété à ses justes proportions. Samuel Johnson, l’écrivain anglais déjà cité, en était un fervent adepte, au point de chapitrer fermement son ami et biographe James Boswell, qui s’irritait un peu trop vivement à son goût d’un malentendu sur l’endroit où devait avoir lieu une réception : « Songez, Monsieur, que tout cela vous paraîtra fort dérisoire dans douze mois. »
Vérité des temps modernes
Une autre façon très efficace de désamorcer la frustration et l’impatience consiste à s’imaginer à quel point la vie serait pénible si on était handicapé. Là encore, il s’agit d’une démarche éminemment pratique : rien, sans doute, ne rend plus supportables les maux dont on souffre que la pensée de tous ceux dont on ne souffre pas.
Durant sa longue existence (1709-1784), Johnson a connu son lot de maladies, de déconvenues et de chagrins, mais il a su en tirer un immense avantage psychologique en se disant que « l’homme habitué aux vicissitudes ne cède pas facilement au découragement ». Sur l’impatience, il avait un point de vue hautement utilitaire. Elle est nuisible, croyait-il, parce qu’elle « consume en récriminations le temps et l’énergie qui pourraient servir à supprimer sa cause ».
De la patience – face noble de la même médaille – il appréciait la « souveraine transmutation des maux », c’est-à-dire l’efficacité avec laquelle elle arrive, sinon à régler, du moins à améliorer les situations difficiles. La précipitation, au contraire, tend à aggraver les choses parce qu’elle pousse à l’action avant qu’on en ait pesé toutes les conséquences.
Ces commentaires renferment une précieuse leçon pour l’électeur d’aujourd’hui. Notre société est si pressée qu’elle se laisse facilement séduire par les candidats qui lui promettent des solutions instantanées et définitives. Une fois au pouvoir, ils sont acculés à prendre très vite des mesures aussi irréfléchies qu’irrémédiables. Des mesures qui, non seulement ne règlent rien, mais souvent laissent les citoyens plus désemparés qu’avant.
Chi va piano va sano
Dans ce cas précis, le philosophe ferait probablement observer que « Rome ne s’est pas bâtie en un jour », manière de rappeler que le travail bien fait demande du temps – environ deux fois plus que prévu à l’origine, quel que soit le projet ! Il dirait aussi que les solutions politiques sont rarement définitives, si mûrement réfléchies qu’elles soient, car « on ne peut contenter tout le monde et son père », autrement dit, attacher toutes les ficelles et satisfaire tous les intérêts.
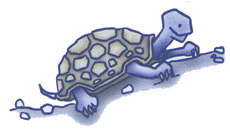
Dans notre société survoltée, la tension engendrée par certains problèmes particulièrement épineux fait malheureusement de plus en plus d’« enragés politiques ». Tels des conducteurs incapables d’attendre calmement la fin de l’embouteillage, ils essaient de débloquer la situation qui les irrite par tous les moyens, sans souci des dégâts qu’ils pourraient causer. C’est à croire que personne en politique ne se souvient de l’antique version grecque de la fable Le lièvre et la tortue. Lentement, mais obstinément, ainsi gagne-t-on la course, conclut Esope. Lorsque le problème est complexe, la course a tout du marathon.
La politique contemporaine a, entre autres défauts, celui de ressasser inlassablement des rancoeurs recuites, de remuer sans cesse le souvenir de fautes anciennes. L’opposition s’abîme dans le rappel des manquements passés du pouvoir, oubliant que sa véritable mission est de critiquer l’action présente du gouvernement et, surtout, qu’« il ne sert à rien de pleurer sur le lait répandu » – en clair, de se lamenter sur les torts qu’on ne peut pas réparer. Non qu’il faille oblitérer le passé; ce serait se condamner à en répéter toutes les erreurs et horreurs. Mais pour avancer, il faut regarder devant soi, pas derrière. Celui qui, le premier, a prié pour avoir « la sagesse d’accepter ce qui ne peut être changé et de changer ce qui peut l’être » était en vérité un grand philosophe.
L’impatience n’altère pas seulement nos comportements publics; elle fausse aussi notre vie privée et, en particulier, notre conception du bonheur. « Tout et tout de suite », voilà un mot d’ordre qui n’a que trop souvent résonné ces dernières années. Ce « tout » désigne en général le pouvoir et l’argent, avec une mesure de célébrité en prime, car dans la vulgate contemporaine, ce sont les trois clés du nouveau paradis terrestre. En réalité, le succès de cette quête personnelle dépend beaucoup de la façon dont on la mène.
L’air le fait pas la chanson
Il faut d’abord accepter qu’il n’y a pas de formule magique du bonheur. Cette vérité transparaît dans les contes et légendes de toutes les cultures : le héros qui voit tous ses voeux exaucés par enchantement n’en devient que plus malheureux. « Il n’y a dans la vie que deux tragédies, écrivait Aristote. La première, ne pas obtenir ce qu’on désire; la seconde, l’obtenir. » Dans la même veine, Benjamin Franklin, ce maître ès sagesse populaire, considérait à sa manière éminemment pragmatique que « si l’homme réalisait la moitié de ses désirs, il doublerait ses peines ».
Ensuite, on doit se répéter constamment que l’argent n’est pas tout. Tant de gens se laissent prendre à ce miroir aux alouettes et sacrifient corps, coeur et âme à la démonstration par l’absurde de la véracité de ce cliché usé, mais toujours d’actualité ! De l’argent, il en faut, certes, mais il est des cas où le jeu ne vaut pas la chandelle. L’argent ne fait pas le bonheur, dit un proverbe. Dans la société contemporaine, on a souvent l’impression du contraire.
Impression d’autant plus forte qu’elle est sciemment entretenue par un système publicitaire tout entier axé sur la transmutation des objets en sentiments. Derrière chaque annonce sur une voiture de luxe bruisse une promesse : achetez-la, et vous serez heureux. Promesse qu’on ne peut pas qualifier de fausse, seulement d’incomplète, l’euphorie diminuant au même rythme que la valeur de l’objet. Les médias confortent ce matérialisme en nous gavant d’images et d’anecdotes sur la vie présumément idyllique de vedettes dont le seul avantage réel sur le commun des mortels est une fortune si considérable qu’elles peuvent tout se permettre.
Peut-être ces célébrités connaissent-elles la félicité parfaite – tout est possible – mais l’expérience humaine suggère plutôt le contraire : tout passe, tout lasse, tout casse, comme le confirme la tragique dérive d’un grand nombre d’idoles du rock. Maxime pour le temps présent : la cocaïne est le moyen inventé par la nature pour avertir l’homme qu’il a trop d’argent !

De toute manière, richesse et célébrité ne sont données qu’à quelques-uns, même dans notre société d’abondance. Pour tous les autres, les sources du bonheur sont à chercher ailleurs, en soi plutôt que hors de soi. « Heureux celui qui ignore son malheur », proclame une béatitude non évangélique. Ce bonheur-là est la juste récompense de ceux qui résistent à l’envie ou qui suivent ce conseil hautement philosophique de l’écrivain américain Frances Rodman : « Pensez comme vous seriez heureux si, après avoir tout perdu, tout vous était subitement rendu. » En vérité, il y a là de quoi vous consoler à tout jamais de ne pas pouvoir satisfaire tous vos caprices.
« Pensez comme vous seriez heureux si, après avoir tout perdu, tout vous était subitement rendu. »
Sagesse en capsules
Pour revenir à Samuel Johnson, ce très grand homme d’esprit et de lettres n’a jamais moqué la sagesse du petit peuple, au contraire ! Il a dressé, en marge du tout premier dictionnaire de la langue anglaise, une anthologie de dictons populaires et de maximes philosophiques. Ses détracteurs l’ont accusé d’avoir voulu les faire passer pour siens, mais s’il faut lui faire un reproche, l’inverse serait plus juste : l’homme aimait à présenter des formules de son cru comme des proverbes.
Qu’est-ce qu’un proverbe ? Il n’y a pas si longtemps, la question aurait paru incongrue, car presque tout le monde connaissait la réponse. Aujourd’hui, c’est moins sûr. Un proverbe est une phrase lapidaire, transmise de génération en génération, qui constitue soit un constat soit un conseil. La plupart ont été formulés il y a très longtemps par des gens simples et sages – les ancêtres des philosophes, au fond. D’ailleurs, les premiers écrits philosophiques en sont truffés.
L’étude des proverbes est-elle plus instructive que celle des traités philosophiques comme le soutenait le poète écossais William Motherwell ? Ce qui est sûr, c’est qu’ils recèlent plus de beauté et de sagesse que les pirouettes intellectuelles de beaucoup de philosophes patentés. Faut-il s’en surprendre ? Ils sont « l’esprit d’un seul et la sagesse de tous », pour en citer un, d’origine anglaise. William Penn, l’homme d’église qui a fondé la Pennsylvanie, exhortait ses ouailles à en apprendre le plus possible et à les méditer souvent. « Ils vous révèlent le sens de la vie humaine, vous en disent long en peu de mots, vous évitent de trop parler et apportent parfois la réponse la plus sûre et la plus parfaite. »
Samuel Johnson n’appréciait pas moins les proverbes et leurs auteurs anonymes : « Nous commettons beaucoup d’erreurs et de sottises non par ignorance, mais par oubli des vrais principes d’action; celui qui sait réduire les grandes règles de la vie à des phrases brèves qui puissent être apprises très tôt et rappelées si fréquemment qu’elles reviennent automatiquement à l’esprit, celui -là est en vérité un bienfaiteur de l’humanité. »
Si nous commettons tant d’erreurs et de sottises aujourd’hui, n’est- ce pas justement parce que nous ne connaissons plus ces vrais principes et grandes règles, que nous ne possédons plus aucun moyen de les rappeler facilement à notre attention ? Jadis, les proverbes faisaient partie de la conversation courante, les enfants les mémorisaient sans y penser, et l’école se chargeait de les leur faire copier et réciter autant de fois que nécessaire pour qu’ils se les gravent de manière indélébile dans leur esprit.
Mais dites à un écolier d’aujourd’hui, ou même à ses parents, que l’enfer est pavé de bonnes intentions ou qu’on ne fait pas d’omelette sans casser d’oeufs, et il n’est pas du tout certain que vous serez compris. Si vous l’êtes, on vous répondra peut-être que ce fatras de clichés n’a plus sa place dans une société qui recherche avant tout la nouveauté (quelle qu’en soit l’utilité sociale) et les sensations fortes.
Un trône pour la philosophie
Si nous comprenions vraiment les règles de la vie en société, serions-nous si prompts à les violer ? La sagesse populaire condamne la violence, mais nous glorifions les « durs », en affaires comme en politique. Au lieu de récompenser la modestie qu’elle nous prêche, nous applaudissons aux excès médiatiques de fanfarons notoires et les aidons par le fait même à devenir célèbres et scandaleusement riches.
La désaffection religieuse explique sans doute une part de cette amnésie collective. Les gens ne vont plus à l’église, n’y amènent plus leurs enfants; or, le sermon était l’un des principaux moyens de transmission de la philosophie populaire. Et puis, notre société hypersophistiquée trouve ces petites phrases tout simplement trop ringardes. Il n’y a pas si longtemps, elles avaient leur place dans le cinéma et la chanson populaires. Les rappers et rockers de cette fin de millénaire préfèrent lancer des appels à la révolution et composer des hymnes à la permissivité.
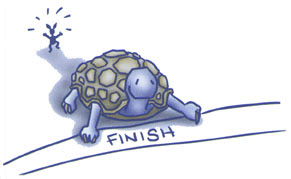
Le déclin de la « grande » philosophie n’arrange pas les choses. Au début du siècle, toute personne un tant soit peu cultivée connaissait au moins superficiellement les théories de Socrate, Platon, Aristote et consorts. Depuis qu’elle a été expulsée des programmes scolaires, cette philosophie-là aussi vivote, retranchée dans la tour d’ivoire universitaire.
Simple ou complexe, la philosophie a longtemps trouvé dans la voix des poètes et des romanciers un moyen de lutter contre son bannissement. Malheureusement, l’écrivain qui se hasarderait aujourd’hui à prendre une position philosophique serait aussitôt accusé de verser dans la morale bourgeoise, crime impardonnable dans un milieu qui s’interdit, au nom de la liberté intellectuelle, de suggérer à ses lecteurs le moindre critère éthique.
À quoi tout cela nous a-t-il menés ? Dans un livre publié en 1989, Why Leaders Can’t Lead, Warren Bennis, un expert américain des problèmes de gestion, s’élève contre l’absence de perspective morale et d’esprit civique au sein de l’élite de son pays, ces États -Unis qui étaient jadis la nation la plus idéaliste de la planète. Parti à la recherche de rois-philosophes, il a découvert que les « tricheries, trucages, dissimulations, demi-vérités et compromissions » ont complètement détruit la confiance que le peuple mettait dans ceux qui étaient censés lui montrer la juste voie.
La pénurie de personnalités d’envergure est l’un des principaux reproches qu’on fait à la politique contemporaine, mais il ne faudrait pas oublier qu’en démocratie, les leaders sont à l’image des peuples qui les choisissent. Si les électeurs sont cyniques au point de tolérer des comportements troubles ou malhonnêtes de la part de leurs représentants, ils n’ont au fond que tes chefs qu’ils méritent.
Bennis affirme dans son ouvrage que l’Occident doit réapprendre à faire la distinction entre le bien et le mal, dans des termes que tout le monde puisse comprendre. Notre société a atteint un tel degré d’amoralité qu’il ne serait pas facile d’établir un consensus large sur ce sujet, mais le travail serait moins ardu si les gens recommençaient à mémoriser et à méditer les maximes toutes simples qui ont guidé leurs ancêtres pendant tant de siècles. Pour s’y initier, il leur suffirait de feuilleter une bonne anthologie. Qui sait ? La sagesse qui affleure à chacune de ses pages pourrait même les rendre heureux.

